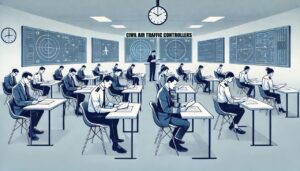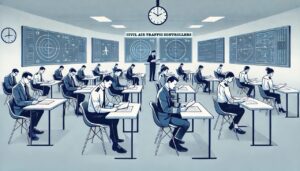📘 Épreuve Instructeur PCRR — Session Décembre 2019
QUESTION 1 : (1.5 pt)
Selon le manuel de gestion de la sécurité, donnez la définition et les types de violations dans le domaine de la sécurité aérienne ?
la violation est définie comme un acte délibéré de faute intentionnelle ou d’omission qui entraîne un écart par rapport aux règlements, procédures, normes ou pratiques établies. La différence fondamentale entre une erreur et une violation réside dans l’intention.
Trois catégories principales de violations :
- Violations situationnelles (Situational violations) : Commises en réponse à des facteurs spécifiques rencontrés sur le moment, tels qu’une charge de travail élevée ou une pression temporelle.
- Violations routinières (Routine violations) : Devenues la manière normale de faire des affaires au sein d’un groupe de travail. Elles surviennent lorsque la conformité aux procédures est jugée difficile, entraînant l’adoption de « contournements » (work-around).
- Violations induites par l’organisation (Organizationally induced violations) : Se produisent lorsqu’une organisation cherche à satisfaire des exigences de production accrues en ignorant ou en étirant ses défenses de sécurité.
QUESTION 2 : (1 pt)
Citez les éléments constituant les approches fondées sur la compétence dans la formation et l’évaluation du personnel ATC ?
Ces éléments sont les suivants :
- Spécification de formation : Document décrivant l’objet de la formation, la liste des tâches et les exigences à respecter au moment de la conception de la formation.
- Modèle de compétence adapté : Groupe des compétences, accompagnées de leur description et des critères de performance associés, établis à partir du cadre de compétence de l’OACI.
- Plan d’évaluation : Document qui décrit les activités et outils d’évaluation (guide d’évaluation, liste de vérification des compétences, formulaire d’évaluation des compétences) qui serviront à déterminer si le niveau de compétence requis a été atteint.
- Plan de formation : Document utilisé pour structurer, élaborer et donner la formation.
- Matériel de formation et d’évaluation : Matériel utilisé pour donner la formation en conformité avec le plan de formation (programme de cours, notes pédagogiques, manuels, présentations, exercices de simulation, etc.)
QUESTION 3 : (1.5 pt)
Quels sont les éléments à prendre en compte lors de la détermination des objectifs d’une formation basée sur les compétences ?
Pour déterminer les objectifs d’une formation basée sur les compétences, il faut d’abord mener une Analyse des besoins de formation (Flux de travail 1). Le résultat de cette analyse est un document clé appelé la « spécification de formation », qui décrit l’état final que le stagiaire doit atteindre.
Les éléments pris en compte pour établir cette spécification (et donc les objectifs de la formation) sont les suivants :
Objet : Quel est l’objet (le but) de la formation?
Tâches : Quelles sont les tâches associées à cet objet?
Exigences opérationnelles :
- Les procédures opérationnelles qui seront appliquées.
- L’environnement opérationnel (réel ou simulé).
- La nature du trafic (type, volume, complexité).
- Les situations non régulières qui doivent être maîtrisées.
- La configuration du poste de travail.
Exigences techniques : Les systèmes ou équipements spécifiques (en situation opérationnelle ou simulée) nécessaires.
Exigences réglementaires : Les règles et règlements applicables, ainsi que toute incidence sur la durée, le contenu ou l’évaluation.
Exigences organisationnelles : Objectifs stratégiques de l’organisme (par exemple, réduction des retards).
Autres exigences : Toute autre contrainte ou besoin (par exemple, bilinguisme).
Équipement de simulation : Le type de simulateur requis, le cas échéant.
QUESTION 4 : (2 pts)
La méthodologie de conception des cours de l’OACI se subdivise en trois grandes catégories, donnez la description de chacune des phases constituant cette méthodologie ?
La méthodologie de développement de cours TRAINAIR PLUS de l’OACI est une approche systémique fondée sur les compétences. Elle se décompose en trois grandes phases (stages) qui se subdivisent en sept étapes spécifiques.
Voici la description concise des trois phases principales :
1. Phase 1 : Analyse (Analysis)
Cette phase est conçue pour fournir à la direction les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée concernant l’approche de formation.
- Objectif : Déterminer quel est exactement le problème que la formation est censée résoudre, quelles en sont les causes, et définir les solutions de formation et de non-formation.
- Étapes incluses : L’étude préliminaire (Step 1), l’analyse de la tâche (Job Analysis) (Step 2) et l’analyse de la population (Population Analysis) (Step 3).
2. Phase 2 : Conception et Production (Design and Production)
C’est la phase où le matériel de formation est conçu et développé en utilisant les résultats de l’Analyse.
- Objectif : Concevoir le curriculum et les modules, puis produire le matériel de formation (y compris le matériel imprimé et audiovisuel) dans son format final. Des essais préliminaires sont menés pour s’assurer que le matériel est adéquat.
- Étapes incluses : La conception du curriculum (Design of Curriculum) (Step 4), la conception des modules (Design of Modules) (Step 5) et la production et les essais préliminaires (Production and Developmental Testing) (Step 6).
3. Phase 3 : Évaluation (Evaluation)
Cette phase constitue l’étape finale du processus de développement.
- Objectif : Mener la livraison de validation (validation delivery), qui est un essai, pour évaluer l’efficacité de la formation, déterminer si les objectifs de performance requis ont été atteints, diagnostiquer les échecs et réviser le matériel si nécessaire.
- Étapes incluses : La validation et la révision (Validation and Revision) (Step 7)
QUESTION 5 : (1 pt)
Quelles sont les dispositions prises par un organisme ATS, lorsqu’une situation d’urgence est déclarée par un aéronef ?
General Actions Upon Emergency Declaration :
- Determine the Nature of the Emergency: The controller should take all steps to determine the nature of the emergency, unless it is clearly indicated by the flight crew or otherwise known.
- Obtain Intentions: The intentions of the flight crew must be obtained.
- Action Based on Emergency: The controller should take the necessary action dictated by the nature of the emergency.
- Provide Information: Provide relevant information, such as details on usable aerodromes, minimum safe altitudes, and meteorological conditions.
- Obtain Additional Data: Obtain the following information from the operator or flight crew, if it cannot be obtained from other sources: the number of persons on board, the amount of fuel remaining, and the presence and nature of any hazardous goods aboard.
- Advise Authorities: Advise the competent ATS units and authorities as specified in local instructions.
- Prioritization: An aircraft known or believed to be in an emergency must be given priority over other aircraft.
- Communication and Maneuvers: Frequency and SSR code changes should be avoided if possible, and generally only executed if an improved service can be provided. Maneuvering instructions for an aircraft experiencing engine failure should be kept to a minimum. Other aircraft flying in the vicinity of the emergency aircraft should be informed of the circumstances if necessary.
- Monitoring: The flight progression of an aircraft in an emergency should be monitored and, whenever possible, displayed on the situation display until the aircraft leaves the coverage area of the ATS surveillance system. Position information must be supplied to all air traffic services units that may be capable of assisting the aircraft. Transfers to adjacent sectors should be performed as needed
QUESTION 6 : (1 pt)
Citez et expliquez les approches de gestion de la fatigue dans le domaine aérien ?
Deux méthodes distinctes pour gérer la fatigue. Les deux approches doivent être fondées sur des principes scientifiques, des connaissances et l’expérience opérationnelle :
1. L’approche prescriptive (Prescriptive Approach):
Explication : L’approche prescriptive exige que le fournisseur de services (exploitant) se conforme à des limitations de temps de service (duty time limits) qui sont définies par l’État.
Fonctionnement :
- L’État établit des règles fixes, telles que des périodes de travail maximales et des périodes de repos minimales.
- L’exploitant doit gérer ses risques liés à la fatigue à l’intérieur de ces limites prescrites, en utilisant les processus de son Système de Gestion de la Sécurité (SMS) existant.
- Dans cette approche, la fatigue est considérée comme l’un des dangers possibles que le SMS doit prendre en compte. Cependant, des données spécifiques à la fatigue ne sont pas activement collectées, sauf si un problème de fatigue a été identifié par le SMS.
2. L’approche basée sur la performance (Performance-based Approach) / SGRF (FRMS):
Explication : L’approche basée sur la performance exige que le fournisseur de services mette en œuvre un Système de Gestion des Risques liés à la Fatigue (SGRF), ou Fatigue Risk Management System (FRMS), qui doit être approuvé par l’État.
Fonctionnement :
- Le SGRF (FRMS) est défini comme un moyen fondé sur les données (data-driven) de surveiller et de gérer en continu les risques de sécurité liés à la fatigue.
- Il est basé sur des principes scientifiques, des connaissances et l’expérience opérationnelle, et vise à garantir que le personnel concerné exécute ses tâches à des niveaux d’éveil adéquats.
- Contrairement à l’approche prescriptive (qui gère un risque prédit général), le SGRF se concentre sur la gestion du risque de fatigue réel (actual fatigue risk) spécifique aux opérations de l’exploitant.
- Le SGRF permet une plus grande flexibilité opérationnelle et une utilisation plus efficace des ressources, mais exige des processus supplémentaires pour garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui de l’approche prescriptive.
QUESTION 7 : (1 pt)
Donner la définition et les composants du FRMS (Système de gestion des risques liés à la fatigue) ?
Définition du SGRF (FRMS)
Le Système de Gestion des Risques liés à la Fatigue (FRMS) est défini comme :
Un moyen fondé sur les données (data-driven) de surveiller et de gérer en continu les risques de sécurité liés à la fatigue, basé sur des principes scientifiques, des connaissances et l’expérience opérationnelle, qui vise à garantir que le personnel concerné exécute ses tâches à des niveaux d’éveil adéquats.
Composants du SGRF (FRMS)
Un SGRF (FRMS) comporte quatre composants, dont deux sont axés sur les opérations et deux sur l’organisation:
1. Politique et documentation SGRF (FRMS Policy and Documentation)
- Il s’agit d’un composant organisationnel.
- Il comprend la politique SGRF (FRMS Policy), qui doit être signée par le dirigeant responsable, et la documentation SGRF (FRMS Documentation) qui décrit tous les éléments du système.
2. Processus de gestion des risques de fatigue (Fatigue Risk Management – FRM – Processes)
- Il s’agit d’un composant opérationnel.
- Ce sont les processus quotidiens qui permettent au fournisseur de services d’atteindre ses objectifs de sécurité.
- Ils comprennent l’identification des dangers (prédictive, pro-active et réactive), l’évaluation des risques et l’atténuation des risques.
3. Processus d’assurance de la sécurité SGRF (FRMS Safety Assurance Processes)
- Il s’agit d’un composant opérationnel.
- Ces processus vérifient le bon fonctionnement de l’ensemble du SGRF.
- Ils comprennent la surveillance de la performance de la sécurité du SGRF (via les SPI), la gestion du changement et l’amélioration continue.
4. Processus de promotion SGRF (FRMS Promotion Processes)
- Il s’agit d’un composant organisationnel.
- Ces processus soutiennent les activités opérationnelles.
- Ils comprennent les programmes de formation SGRF (FRMS Training Programmes) et un plan de communication SGRF (Communication Plan).
QUESTION 8 : (1 pt)
Quelles sont les conditions requises pour la délivrance de la carte d’instructeur ?
La carte d’instructeur est délivrée à tout contrôleur remplissant les conditions suivantes :
- Être en possession d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne en cours de validité.
- Justifier d’une expérience d’au moins deux ans d’exercice des privilèges de la qualification du premier contrôleur régional radar ou du premier contrôleur d’approche radar.
- Justifier d’une expérience d’au moins une année d’exercice de la qualification sur l’unité choisie pour l’instruction.
- Avoir réussi les épreuves théoriques et pratiques.
- Avoir suivi avec satisfaction une formation d’instructeur (conformément au programme en annexe 1) après avoir été admis aux épreuves.
- Déposer une demande d’obtention de la carte d’instructeur (via le formulaire en annexe 2, la circulaire 4054-DAC).
QUESTION 9 : (1 pt)
Quand est-ce qu’un contrôleur détenteur d’une qualification donnée, peut être autorisé à exercer les privilèges de sa qualification dans un organe de contrôle similaire ?
L’autorisation pour un contrôleur (ATCO) de détenir et d’exercer les privilèges d’une qualification (ex. : ADC, APP, ACS, etc.) dans un nouvel environnement opérationnel ou un organe de contrôle similaire est obtenue après la réussite de l’étape de la Formation en unité.
La formation en unité vise à permettre au stagiaire de se préparer en vue de l’obtention d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, d’une qualification pertinente ou d’un poste dans une unité particulière. Lorsque l’ATCO a déjà la qualification requise, la formation en unité lui permet de se préparer à travailler dans une unité précise, dans des secteurs particuliers ou dans différents postes dans cette unité.
QUESTION 10 : (1 pt)
En cas de perte de licence suite à une inaptitude prononcée par un centre d’expertise en médecine aéronautique ou un médecin examinateur, est-ce que la carte d’instructeur reste toujours valide ?
Selon la circulaire 4054-DAC, dans ce cas précis, la carte d’instructeur peut demeurer valide mais uniquement pour assurer l’instruction sur simulateur.
La carte portera alors la mention « uniquement sur simulateur ».
C’est le Directeur de l’Aéronautique Civile qui statue sur ce point, conformément à l’avis du comité des experts en médecine aéronautique. Il peut alors soit :
- Retirer définitivement la carte d’instructeur ;
- Accorder au détenteur le droit d’assurer l’instruction uniquement sur simulateur.
QUESTION 11 : (1 pt)
Quelles sont les tâches que devrait assurer un détenteur de carte d’instructeur ?
Tout instructeur doit dispenser la formation conformément aux manuels, programmes et plans de formation approuvés par le Directeur de l’Aéronautique Civile.
La carte d’instructeur exige de son titulaire d’assurer les tâches suivantes :
- Mettre à niveau les compétences du contrôleur stagiaire en termes d’utilisation de nouveaux standards, procédures, techniques, facilités et équipements nécessaires en vue d’exercer les privilèges de la qualification de contrôle prétendue.
- Évaluer et reporter l’état d’avancement et le niveau de performance du contrôleur stagiaire ou contrôleur en phase d’instruction, en notifiant toute insuffisance de connaissances et proposer les formations et/ou stage adéquats pour y remédier.
- Évaluer les formations d’instruction dispensées et proposer des points d’amélioration.
De plus, l’instructeur sur la position est responsable de la sécurité de la gestion du trafic aérien lors des formations qu’il dispense sur la position.
QUESTION 12 : (2 pts)
Citer les stratégies de sécurité qui doivent être mises en place pour maîtriser les erreurs ou les éliminer ?
Les stratégies de sécurité pour maîtriser ou éliminer les erreurs humaines comprennent :
1. La Conception du Système (Prévention/Élimination) :
Assurer un apport adéquat de connaissances sur les facteurs humains dès les stades de la planification et de la conception du système, afin de déceler les sources potentielles d’erreur assez tôt pour pouvoir les éliminer.
2. La Tolérance à l’erreur :
Concevoir le système de manière à ce qu’il soit « tolérant à l’erreur » et qu’il reste sûr lorsque des erreurs se produisent, car il n’est pas raisonnable de penser que toute erreur humaine peut être évitée.
3. La Détection et la Correction (Opérationnel) :
- La détection par les opérateurs humains eux-mêmes ou par leurs collègues dans un environnement d’équipe.
- La détection par les machines, qui peuvent être programmées pour déceler et prévenir les erreurs humaines (par exemple, en n’acceptant pas des actions incorrectes).
QUESTION 13 : (1.5 pt)
La démarche d’instruction dispensée par un instructeur à un contrôleur est composée de cinq parties dans la circulaire N°4055 DAC/DNA/SCA, expliquer en quoi consistent les tâches et les sous-tâches de l’instructeur durant la première et la cinquième partie ?
1. Première partie : OJT1: Préparation de la formation
- Tâche : OJT1: Préparation de la formation
- Sous-tâches :
- OJT1.1 : Déterminer les connaissances et l’expérience du contrôleur stagiaire ;
- OJT1.2 : Déterminer le niveau de compétence du contrôleur stagiaire (en ayant une idée sur les formations suivies par le contrôleur stagiaire, avis de ses chefs hiérarchiques…) ;
- OJT1.3 : Etablir un plan de formation.
2. Cinquième partie : OJT5: Evaluation du contrôleur Stagiaire
- Tâche : OJT5: Evaluation du contrôleur Stagiaire
- Sous-tâches :
- OJT5.1 : Evaluer la performance du contrôleur stagiaire au cours de la formation ;
- OJT5.2 : Etablir des rapports écrits ;
- OJT5.3 : Débriefer le contrôleur stagiaire ;
- OJT5.4 : Entreprendre les actions de suivi appropriées.
QUESTION 14 : (1.5 pt)
Citez les principes de l’utilisation flexible de l’espace aérien (FUA) ?
L’objectif principal de la souplesse d’utilisation de l’espace aérien est d’accroître la capacité et d’améliorer l’efficacité et la souplesse de l’exploitation aérienne. Pour ce faire, les autorités compétentes sont tenues de prendre des dispositions par l’établissement d’accords et de procédures.
Les accords et procédures qui permettent cette souplesse d’utilisation de l’espace aérien doivent spécifier, entre autres, les principes ou éléments suivants :
- Les limites horizontales et verticales de l’espace aérien considéré.
- La classification de tout espace aérien rendu disponible pour être utilisé par la circulation aérienne civile.
- Les organismes ou autorités responsables du transfert d’espace aérien.
- Les conditions du transfert d’espace aérien à l’organisme ATC intéressé.
- Les conditions du transfert d’espace aérien par l’organisme ATC intéressé.
- Les périodes de disponibilité de l’espace aérien.
- Toutes restrictions à l’utilisation de l’espace aérien considéré.
- Toutes autres procédures ou informations pertinentes.
L’implémentation de ces mesures vise à garantir une gestion dynamique et intégrée de l’espace aérien.
QUESTION 15 : (1.5 pt)
Quels sont les facteurs à prendre en compte pour l’évaluation de la capacité ATC ?
Pour l’évaluation de la capacité, les facteurs à prendre en compte devraient comprendre :
- a) le niveau et le type de services ATS fournis ;
- b) la complexité structurelle de la région de contrôle, du secteur de contrôle ou de l’aérodrome considéré ;
- c) la charge de travail des contrôleurs, y compris les tâches de contrôle et de coordination à accomplir ;
- d) les types de systèmes de communications, de navigation et de surveillance utilisés, leur degré de fiabilité et de disponibilité techniques, ainsi que la disponibilité de systèmes et/ou procédures de secours ;
- e) l’existence de systèmes ATC assurant des fonctions d’appui aux contrôleurs et d’alarme ;
- f) tout autre facteur ou élément jugé pertinent pour ce qui concerne la charge de travail des contrôleurs.
QUESTION 16 : (1 pt)
Quelles sont les mesures prises lors de la phase de planification pré-tactique de la gestion des courants de trafic aérien ATFCM ?
La planification prétactique devrait affiner le plan stratégique, à la lumière des données actualisées sur la demande. Au cours de cette phase :
- a) certains courants de trafic peuvent être réacheminés ;
- b) des routes de délestage peuvent faire l’objet d’une coordination ;
- c) des mesures tactiques seront décidées ;
- d) des précisions pour le plan ATFM du lendemain devraient être publiées et mises à la disposition de tous les intéressés.